| |
C'
est après la seconde guerre mondiale, dans une nouvelle orientation
de reconstruction générale et de développement de
la production, que s' amorce l' idée d' un assèchement important
du Marais. |
|
|
|

Vaches paissant le long de la Sèvre Niortaise. |
|
 A
partir de 1960, jugés insuffisamment productifs, les grands marais
communaux qui servaient en général à la pâture
collective des bêtes seront démembrés et progressivement
mis en culture, ou feront l' objet de reconversion non agricoles. A
partir de 1960, jugés insuffisamment productifs, les grands marais
communaux qui servaient en général à la pâture
collective des bêtes seront démembrés et progressivement
mis en culture, ou feront l' objet de reconversion non agricoles.
Ce nouveau mouvement
s' amorcera réellement en faveur de la culture des céréales,
mais en défaveur de l' élevage:
et s' il s' avère nécessaire de protéger les terres
de trop fortes inondations en hiver, il convient également de
trouver les réserves d' eau nécessaires en été
pour arroser les champs, surtout ceux de maïs: l' on pensera un
temps trouver la solution auprès
les nappes aquifères du sous-sol, mais cela ne se vérifiera
pas.
|
|
|
En
1976, une nouvelle loi de protection de la nature est votée
en France;
deux tendances s' affrontent alors: les tenants d' une agriculture moderne
supposant de nombreux remembrements et aménagement hydrauliques,
et de l' autre, les défenseurs de l' environnement et éleveurs
traditionnels souhaitant le maintien d' un marais humide et de ses prairies
naturelles pour l' élevage. |
|
|
 C' est dans ce contexte
idéologique que la création d' un Parc Naturel Régional
est amorcée, C' est dans ce contexte
idéologique que la création d' un Parc Naturel Régional
est amorcée,
-
afin d' essayer de concilier la préservation de la faune et flore
locales au sein d' un beau paysage,
- aider les régions agricoles à se développer pour
lutter contre l' exode rural de la population
- et ranimer l' économie locale.
|

Marais typique, avec ses frênes-têtards.
|
|
|
 |
|
|
 Après
dix années de concertation, en 1979, ce Parc Naturel
Régional est crée sous forme d' un syndicat mixte
regroupant toutes les collectivités territoriales impliquées:
Après
dix années de concertation, en 1979, ce Parc Naturel
Régional est crée sous forme d' un syndicat mixte
regroupant toutes les collectivités territoriales impliquées:
deux régions:
région du Poitou-Charentes et des Pays de Loire
trois départements: Deux-Sèvres, Charente-Maritime et Vendée
plus 108 communes du Marais et de sa périphérie. |
|
|
 |
|
 De 1975
à 1990, c' est quand même l' assèchement
du Marais qui a prévalu: 30.000 ha de terres ayant été
labourées pour la mise en culture, sans doute parce que les agriculteurs
ne disposaient pas des moyens nécessaires pour garder nombre
de terres à faible rendement financier,
De 1975
à 1990, c' est quand même l' assèchement
du Marais qui a prévalu: 30.000 ha de terres ayant été
labourées pour la mise en culture, sans doute parce que les agriculteurs
ne disposaient pas des moyens nécessaires pour garder nombre
de terres à faible rendement financier,
avec des prélèvements d' eau importants pour les grandes
plaines céréalières, dans une nappe acquifère
fragile n' alimentant plus correctement le Marais en été.
Ces dispositions
ont amené Brice LALONDE, ministre de l' environnement à
l' époque, à suspendre le label de Parc Naturel Régional,
et malgré l' essai de négociations, ce Parc Naturel cessera
d' exister le 31 décembre 1996.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Devenu inadapté,
l' ancien label cèdera la place à une reprise des négociations
entre l' Etat et les collectivités locales avec le ministre de
l' environnement: Corinne LEPAGE,
Devenu inadapté,
l' ancien label cèdera la place à une reprise des négociations
entre l' Etat et les collectivités locales avec le ministre de
l' environnement: Corinne LEPAGE,
c' est ainsi qu' un nouveau programme d' action sera confié à
l' actuel syndicat mixte dont les statuts modifiés, regroupent
les deux mêmes régions et les trois mêmes départements,
plus 75 communes, composant le
nouveau Parc inter régional du Marais Poitevin,
dans la délicate
mission de concilier:
- la protection des espaces naturels, faune et flore
- assurer le développement économique, agricole, et touristique
de la région en protégeant les cadre et niveau de vie
des habitants
- participer au maintien du patrimoine, culture et éducation,
ceci dans la seconde
zone humide de France derrière la Camargue, composée de
paysages très diversifiés comprenant des Marais mouillés,
des Marais desséchés, des Marais intermédiaires,
plaines et des zones côtières, dont la répartition
actuelle est représentée sur la carte ci-dessous:
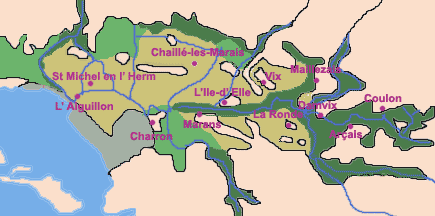

|
|
|
|
|
|
|
Projet
Natura 2000 |
|
|
|
|
L' Etat français
a confié au Parc Inter régional, en Avril 2001,
la mise en oeuvre du dossier Natura 2000 concernant la région
du marais Poitevin, réseau qui se met en place à l' échelle
des Etats Membres de l ' Union Européenne, en vue de:
- protéger
les sites naturels: prairies humides, estuaires, vasières.. voire
essayer d' en augmenter la surface,
- protéger les populations des oiseaux migrateurs, ainsi que
plusieurs espèces d' insectes, amphibiens et reptiles,
- ce, en concertation avec la participation des agriculteurs qui devront
recevoir des compensations financièrement adaptées afin
de pouvoir couvrir la baisse de leurs revenus
due à une remise en prairie de certaines parcelles,
- et en partenariat avec toute la dynamique qui assure l' entretien
des canaux et la restauration des ouvrages.
|
|
|
|
 Souhaitons qu' un équilibre général
dans le respect de chacun puisse être trouvé,
Souhaitons qu' un équilibre général
dans le respect de chacun puisse être trouvé, 
afin de conserver à cette région sa biodiversité,
et le charme indicible qui s' en dégage. |
|
|
|
|
 Il est fréquent au hasard des promenades, de croiser de gros
engins s' occupant du curage des canaux:
Il est fréquent au hasard des promenades, de croiser de gros
engins s' occupant du curage des canaux:
ici pour la première
fois il m' a été donné l' occasion d' assister
à la mise en place d' immenses pieux pour la réfection
et consolidation des rives de la Sèvre.
|
 |
|
| |
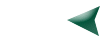

|
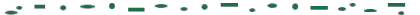 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




